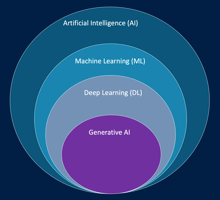L’intelligence artificielle (IA) désigne un ensemble de technologies et de méthodes visant à créer...
Introduction aux LLMs
Introduction
Les Grands Modèles de Langage, ou Large Language Models (LLMs), sont une catégorie d’intelligence artificielle conçue pour comprendre, générer et manipuler le langage humain.
Ils constituent aujourd’hui la base de nombreuses applications comme les assistants conversationnels, les outils de génération de texte, les systèmes de recherche sémantique, ou encore la traduction automatique.
Leur principe repose sur une idée simple : apprendre à prédire la suite la plus probable d’un texte à partir d’un contexte donné.
En d’autres termes, un LLM apprend à deviner le mot suivant d’une phrase, mais à une échelle gigantesque et avec une finesse de contexte qui dépasse largement les approches traditionnelles.
1. Le principe fondamental : prédire le mot suivant
Le cœur du Machine Learning appliqué au langage est la prédiction du mot suivant.
Par exemple, si le modèle lit la phrase :
« Le chat dort sur le… »
Il doit prédire quel mot est le plus probable après cette séquence. Les mots possibles pourraient être « canapé », « lit », ou « tapis ». Le modèle choisit celui qui a la plus forte probabilité selon ce qu’il a appris pendant l’entraînement.
Cette simple tâche de prédiction répétée des milliards de fois permet au modèle d’apprendre :
-
la grammaire du langage,
-
la signification des mots,
-
les relations entre les phrases,
-
et même la logique implicite derrière certaines idées.
2. La tokenisation : découper le texte en unités compréhensibles
Les LLMs ne lisent pas directement des mots entiers, mais des tokens.
Un token est une unité élémentaire de texte. Cela peut être :
-
un mot complet,
-
une partie de mot,
-
ou parfois un simple caractère ou symbole.
Par exemple, la phrase :
« Les étudiants apprennent. »
peut être convertie en tokens tels que :
["Les", " étudiants", " apprennent", "."]
Le texte est donc converti en une suite de nombres (embeddings) correspondant à ces tokens.
C’est cette représentation numérique qui sera ensuite utilisée par le modèle pour effectuer ses calculs.
La tokenisation permet de traiter efficacement les langues naturelles tout en gérant la diversité des mots, des accents ou des formes grammaticales.
3. Les embeddings : représenter le sens des mots en nombres
Une fois le texte découpé en tokens, il faut que le modèle comprenne leur signification.
Pour cela, chaque token est converti en un vecteur numérique, appelé embedding.
Un embedding est une représentation mathématique d’un mot dans un espace vectoriel.
Chaque mot est positionné de manière à ce que des mots au sens proche soient placés à proximité les uns des autres.
Par exemple, les vecteurs de chat et chien seront proches, tandis que chat et avion seront éloignés.
Cette représentation permet au modèle de raisonner sur le sens plutôt que sur la simple forme des mots.
Ainsi, il peut comprendre que « roi » et « reine » sont liés à « genre », ou que « Paris » et « France » entretiennent une relation similaire à « Rome » et « Italie ».
4. L’architecture Transformer : le cœur des LLMs
Le Transformer est l’architecture sur laquelle reposent tous les grands modèles de langage modernes (GPT, BERT, Claude, Llama, etc.).
Cette architecture a remplacé les anciens modèles séquentiels (comme les RNN et LSTM) grâce à sa capacité à traiter le contexte global d’un texte en une seule fois.
Deux mécanismes principaux la caractérisent :
a) L’attention (Self-Attention)
Le mécanisme d’attention permet au modèle de pondérer l’importance de chaque mot dans une phrase.
Autrement dit, il apprend à « prêter attention » aux mots les plus pertinents pour comprendre le sens global.
Par exemple, dans la phrase :
« Le chat que le garçon caressait était noir. »
le modèle comprend que « noir » décrit le chat et non le garçon, grâce à l’attention.
b) L’empilement de couches
Le transformer est composé de couches empilées (souvent plusieurs dizaines, voire centaines).
Chaque couche affine la compréhension du texte : les premières couches saisissent des structures simples (syntaxe, mots proches), tandis que les dernières couches apprennent des relations conceptuelles complexes (intention, logique, ton).
5. Le processus d’entraînement
a) Pré-entraînement
Le modèle est d’abord entraîné sur des milliards de phrases provenant de sources variées (livres, articles, pages web, conversations).
Pendant cette phase, il apprend les régularités du langage : comment les mots s’enchaînent, les structures grammaticales, les nuances de sens, etc.
L’objectif est d’obtenir un modèle généraliste capable de traiter une grande variété de textes.
b) Fine-tuning
Une fois pré-entraîné, le modèle est ajusté (ou fine-tuned) sur des tâches spécifiques :
par exemple, résumer des documents, répondre à des questions, écrire du code, ou dialoguer de manière naturelle.
c) Alignement et supervision humaine
Enfin, les développeurs affinent le modèle grâce à des retours humains.
Cette étape, appelée RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), consiste à faire évaluer les réponses du modèle par des humains, qui indiquent celles qu’ils jugent les plus appropriées.
Le modèle apprend alors à produire des réponses plus fiables, cohérentes et socialement acceptables.
6. Les capacités des LLMs
Une fois entraînés, les LLMs sont capables de réaliser une multitude de tâches sans entraînement supplémentaire (on parle de capacité de généralisation).
Ils peuvent notamment :
-
Résumer ou reformuler des textes,
-
Traduire des langues,
-
Répondre à des questions complexes,
-
Analyser des sentiments ou des opinions,
-
Générer du code ou du contenu créatif.
Leur force réside dans leur compréhension contextuelle : ils ne se limitent pas à des mots isolés, mais perçoivent les relations entre les idées.
7. Limites et précautions
Malgré leur puissance, les LLMs présentent plusieurs limites :
-
Ils ne comprennent pas réellement le monde : ils prédisent des mots en fonction de probabilités, sans conscience ni raisonnement humain.
-
Ils peuvent halluciner : produire des informations fausses mais formulées avec confiance.
-
Ils reproduisent les biais présents dans les données d’entraînement.
-
Ils exigent des ressources considérables pour l’entraînement et l’exécution.
Il est donc essentiel de les utiliser dans des cadres contrôlés, en validant systématiquement les résultats produits.
Conclusion
Les Grands Modèles de Langage marquent une étape décisive dans l’histoire de l’intelligence artificielle.
Ils ne se limitent plus à traiter des données : ils dialoguent, raisonnent et adaptent leur langage à leurs interlocuteurs.
Pour un apprenant en intelligence artificielle ou un futur certifié AWS AI Practitioner, comprendre le fonctionnement des LLMs — de la tokenisation aux embeddings, en passant par l’attention — constitue une base essentielle pour aborder les applications modernes de l’IA.
Ces modèles ouvrent des perspectives considérables, mais leur utilisation requiert discernement, compréhension technique et responsabilité.
--
Ce billet de blog fait partie du cours AWS AI Practitioner en français disponible sur Udemy et sur la plateforme LeCloudFacile.com.